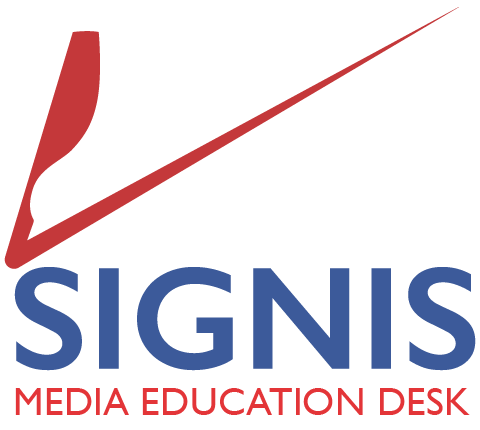L’Amérique latine et l’IA : régulation ou dépendance technologique ?

Sur notre continent, non seulement on s’inquiète des conséquences du développement technologique pour ses habitants et pour la planète, mais les réglementations mises en œuvre rencontrent encore des obstacles à leur progression.

37% des citoyens s’accordent à dire que l’intelligence artificielle pourrait accroître les inégalités dans leur pays. CRAVETIGER (GETTY IMAGES )
NATALIA ZUAZO . El Pais, Espagne
Début 2025, tous les regards sur la technologie et l’intelligence artificielle se sont tournés vers le nord du monde, avec deux développements importants. Lors de sa deuxième investiture, Donald Trump a confirmé l’alignement des propriétaires des grandes entreprises technologiques avec l’administration républicaine. La motion comprenait l’abrogation du décret exécutif 14110 de 2023, qui proposait « le développement et l’utilisation sûrs, sécurisés et dignes de confiance de l’intelligence artificielle ». Et cela a été couronné par la nomination d' Elon Musk à la tête du Département de l'efficacité gouvernementale , un organisme extrêmement technocratique qui cherche à lutter contre les excès de la bureaucratie, même si d'autres avertissent que cela irait à l'encontre des fondements mêmes de la démocratie.
Un mois plus tard, le Sommet d’action sur l’IA organisé par Emmanuel Macron à Paris devait servir de contrepoids aux efforts pour « une intelligence artificielle inclusive et durable pour les personnes et la planète ». Cependant, cela s’est avéré être une déception. Des universitaires, des membres de la société civile et des militants, notamment du Sud global, ont fait écho à sa plainte : la réunion européenne n'a été rien de plus que le lancement d'un investissement de 109 milliards d'euros pour « faire de la France une puissance de l'IA » et positionner le pays dans la même course que les États-Unis et la Chine, mais une course monétisée par les hommes les plus riches du monde.
Ce scénario géopolitique, qui est sur le point de faire progresser les développements technologiques sans limites, semble ne laisser à l’Amérique latine d’autre choix que de s’adapter ou de débattre de scénarios alternatifs. Mais si l’on regarde vers l’intérieur, des études récentes indiquent que sur notre continent, non seulement on s’inquiète des conséquences du développement technologique pour ses habitants et pour la planète, mais les réglementations mises en œuvre rencontrent encore des obstacles à leur avancement.
Selon une étude menée par Luminate et Ipsos en Argentine, au Brésil, en Colombie et au Mexique en 2024, 55 % des personnes sont favorables à la réglementation de l’intelligence artificielle. La proportion monte à 65% parmi ceux qui déclarent avoir une bonne connaissance ou avoir utilisé ces outils. Dans la région la plus inégalitaire du monde, 37 % des citoyens conviennent que l’intelligence artificielle pourrait accroître les inégalités dans leur pays. « Avec l'IA, nous avons l'opportunité d'apprendre des erreurs que nous avons commises avec les plateformes de médias sociaux, où les conséquences d'un manque de responsabilité se font sentir dans toute notre région, de la propagation incontrôlée de la désinformation et des discours de haine à la polarisation et à la surveillance accrues », a déclaré Felipe Estefan, vice-président de Luminate pour l'Amérique latine. Sur ce continent, 54 % des personnes interrogées s’opposent à l’utilisation de l’IA pour prendre des décisions devant les tribunaux, 51 % s’opposent à son utilisation pour rédiger des lois et 50 % trouvent inacceptable l’utilisation de l’IA pour déterminer qui est éligible aux prestations sociales.
Réglementations et limites
Au cours de l’année 2024, plusieurs pays d’Amérique latine ont réalisé des progrès en matière de réglementation. Un cas notable est celui du Brésil, dont le Sénat a approuvé un projet de loi visant à établir des normes pour une gouvernance responsable des systèmes d’intelligence artificielle. Le texte, qui doit être transmis à l'autre chambre pour approbation, s'inspire de la loi sur l'IA de l'Union européenne en proposant un système de catégorisation des risques et d'interdiction de la mise en œuvre de ceux qui affectent les personnes, tout en imposant des obligations d'évaluation d'impact aux développeurs. Pour écarter les faux dilemmes, le projet « part du principe qu’il n’existe pas de dilemme – un choix mutuellement exclusif – entre la protection des droits et libertés fondamentaux, la valorisation du travail et de la dignité de la personne humaine face à l’ordre économique, et la création de nouvelles chaînes de valeur. »
Le processus brésilien est en cours. Tout a commencé en 2022 avec la création de divers comités et ébauches du projet, où le secteur privé a tenu une grande partie des auditions. Selon une étude menée par Intercept Brasil et Derechos Digitales , 31 % des espaces de débat étaient occupés par des entreprises, tandis que le monde universitaire et la société civile y participaient respectivement à 26 % et 19 %. The Intercept a également révélé que les représentants des entreprises se sont, dans de nombreux cas, présentés aux audiences en tant que membres d'autres secteurs, démontrant ainsi l'intérêt des entreprises technologiques à s'opposer à cette réglementation et leur important pouvoir de lobbying pour déguiser leurs intérêts en intérêts étrangers. Entre-temps, d’autres initiatives ont progressé avec un succès variable dans la région.
Selon l’ Indice latino-américain d’intelligence artificielle (ILIA) , compilé par la CEPALC, le Chili, le Brésil et l’Uruguay sont les pays qui ont non seulement progressé dans la mise en œuvre des technologies basées sur l’IA, mais qui orientent également leurs stratégies nationales vers la consolidation et l’expansion de ces technologies dans tous les secteurs de leur économie et de leur société. Selon l'agence des Nations Unies, « ils disposent également d'un environnement favorable qui favorise la recherche, le développement et l'adoption de technologies, favorisant l'innovation et l'application de l'IA ». Ils sont suivis par l’Argentine, la Colombie et le Mexique, pays d’une catégorie inférieure, mais en développement.
Malgré ces avancées, le rapport note que des défis persistent en ce qui concerne la participation égale des femmes à la recherche et au développement de l’IA, ce qui nécessite la mise en œuvre de politiques sensibles au genre, même dans les pays les mieux notés en matière d’adoption de politiques pour le secteur. D’autres objectifs à atteindre dans la région incluent l’intégration de meilleures infrastructures et la rétention des personnes formées en technologie : la migration des personnes les plus qualifiées vers la partie nord du monde conspire contre leurs propres modèles.
Sur le plan environnemental, l'Index a intégré en 2024 le facteur de durabilité dans le développement de l'IA, soulignant que « la réflexion sur l'impact environnemental des modèles, notamment leur consommation énergétique, doit être encouragée », car « il est certain que la demande pour cette technologie continuera de croître à moyen terme ». La nécessité de tirer parti des avantages locaux de l’Amérique latine et des Caraïbes pour promouvoir l’utilisation d’énergies propres et l’industrie de l’informatique et du stockage de données est soulignée comme « une voie raisonnable pour accroître la compétitivité et la sophistication des économies ». Il n’y a cependant pas de débat sur la manière de gérer les ressources énergétiques rares et polluantes, en tenant compte non seulement du progrès technologique mais aussi des besoins de développement des pays.
Identité ou dépendance
Dans ce scénario, il convient de se demander comment des régions comme l’Amérique latine peuvent soutenir le développement d’écosystèmes d’intelligence artificielle plus alignés sur leur propre histoire et leur présent, et qui reflètent les valeurs et les besoins locaux. « Notre région est considérée comme fournissant uniquement les ressources naturelles et la main-d’œuvre nécessaires à la chaîne de production mondiale de l’IA », explique Paz Peña , auteur de Technologies for a Planet on Fire et chercheur principal à la Fondation Mozilla. « En tant que continent, nous sommes confrontés à des économies aux racines coloniales. De nombreux pays, de par leur taille, leur situation géographique et leur main-d'œuvre qualifiée, pourraient offrir à cette course au-delà des ressources naturelles, par exemple l'assemblage de puces. Mais envisager nos propres développements en matière d'IA avec une logique extérieure aux géants de la technologie et une perspective locale est quasiment impossible », ajoute-t-il.
Pour que cela se produise, explique Peña, il faudrait investir dans le développement des systèmes, qui dépend d’une infrastructure principalement soutenue par les grandes entreprises technologiques du Nord. « De plus, pour être compétitif, il faudrait d'énormes investissements, et je crois qu'il est éthiquement répréhensible que, compte tenu des graves problèmes de protection sociale que nous connaissons dans nos pays, de l'argent soit investi dans ces jeux spéculatifs qui apportent une richesse fortement concentrée entre les mains de quelques acteurs. »
Paloma Lara Castro, directrice des politiques publiques chez Derechos Digitales, complexifie le débat : « D’après diverses études que nous avons menées depuis 2020, nous avons constaté que l’utilisation de l’IA par les États de la région se concentre dans des domaines critiques : la santé, l’emploi, la justice, l’éducation, l’accès aux prestations sociales, l’information publique et la protection de la sécurité publique. Ce sont des domaines où l’utilisation généralisée de l’IA s’accélère, s’appuyant sur des promesses non prouvées, telles que l’efficacité et l’efficience des dépenses, la prévention de la fraude, la prévision de la criminalité et le décrochage scolaire, entre autres. » Cependant, Lara ajoute que cette course technologique ne s’accompagne pas de la protection des droits, qu’il s’agisse de ceux liés aux données personnelles, aux droits des consommateurs ou à la prévention de nouvelles inégalités. Pour elle, la priorité régionale devrait être de promouvoir des politiques publiques innovantes et participatives qui répondent aux véritables défis de la technologie, et de le faire avec des réglementations, des mécanismes de contrôle indépendants et une véritable participation de la société civile et des communautés affectées. Sinon, prévient-il, « l’IA en Amérique latine risque de devenir un outil de contrôle plutôt qu’une opportunité de développement ».
Paz Peña convient que les questions liées au développement et à l'intelligence artificielle, même avec ces défis importants, doivent être traitées sérieusement et de toute urgence, « depuis les forces d'exploitation de nos ressources naturelles par l'IA, jusqu'au rôle des travailleurs, en passant par le pouvoir limité de nos cadres juridiques locaux pour protéger nos droits contre les forces transnationales. » Pour elle, cela va au-delà des politiques technologiques : il s’agit d’un conflit mondial autour d’une démocratie qui a besoin de plus de transparence et de moins de secrets d’entreprise, y compris d’enquêtes et de responsabilités sur les mécanismes de lobbying que les entreprises technologiques mondialement puissantes exercent sur les gouvernements locaux, quelle que soit leur région du monde.